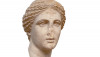La décision de Constantin de lier le destin de l’Empire au christianisme a marqué un tournant, non seulement dans l’histoire de l’Empire romain, mais dans l’histoire mondiale : sans un empire chrétien, l’islam n’aurait jamais vu le jour et le judaïsme aurait probablement disparu depuis longtemps (je reviendrai plus tard sur ces points).
La décision de Constantin était-elle politique ou religieuse ? La distinction ne peut être faite de manière tranchée à cette époque, car chaque ville, royaume ou empire était sous la protection de ses dieux. Eusèbe de Césarée indique clairement que Constantin a choisi le Christ avec la conviction qu’il avait donné à son père et à lui-même la victoire sur le champ de bataille et qu’il lui assurerait un règne sûr et prospère.
Après avoir vaincu Maxence, Constantin ne remit plus jamais les pieds à Rome, ville incorrigiblement fidèle à ses racines païennes (voir mon précédent article), et immédiatement après avoir vaincu Licinius en 324, il fonda Constantinople (inaugurée en 330), où les seuls édifices religieux construits seraient chrétiens. Un an plus tard, il prit en main les affaires de l’Église et convoqua le premier concile « œcuménique » à Nicée (aujourd’hui Iznik en Turquie). Il le présida, assista à certaines délibérations et obligea tous les évêques réunis à accepter la déclaration doctrinale finale, sous peine d’être exilés.
La controverse d’Arius
Le principal enjeu était le conflit qui avait éclaté en Afrique du Nord entre le prêtre ascétique Arius et l’évêque d’Alexandrie, Alexandre. Tous deux acceptaient que le Christ, le Fils de Dieu, était également le Logos des néoplatoniciens, né avant la création de l’univers. Mais alors qu’Arius soutenait que le Fils était inférieur au Père qui l’avait engendré, Alexandre insistait sur le fait que le Fils était coéternel au Père et que tous deux étaient de la même ousia (« substance » ou « essence »). Le différend n’était pas nouveau, mais il avait pris une dimension politique avec la faveur impériale accordée au christianisme. La position d’Alexandre était défendue par le jeune diacre Athanase, que Harold Drake décrit comme « passionné, éloquent et impitoyable », et doté « des compétences d’un combattant acharné et d’un politicien de rue » [1].
Sous l’influence d’Athanase, le concile de Nicée adopta une résolution, aujourd’hui appelée le Credo de Nicée, déclarant que le Fils est homoousios (de même substance ou essence) que le Père. Arius fut condamné à l’exil avec ses inflexibles partisans. Peter Heather souligne que « la controverse arienne n’est pas (comme on le présente souvent) une histoire de déviation par rapport à un ensemble de croyances chrétiennes bien définies et établies de longue date, mais une lutte intense pour en établir un pour la première fois » [2]. Il est également essentiel de noter que, par décision de l’empereur, la doctrine correcte (orthe doxa) a été déclarée non seulement nécessaire au salut, mais juridiquement obligatoire.
Malheureusement pour Constantin, les croyances religieuses résistent à l’autorité politique. De nombreux évêques qui avaient été contraints de signer le Credo de Nicée se sont ensuite rétractés. Sous la direction intellectuelle de l’évêque de Nicomédie, Eusèbe, un consensus s’est dégagé pour éviter l’utilisation du terme non évangélique ousia et appeler le Fils simplement « similaire » (homoios) au Père, tout en admettant, contre Arius, que le Fils existait depuis toute éternité.
En 328, Athanase remplaça Alexandre comme évêque d’Alexandrie, mais en 335, une délégation d’évêques rencontra Constantin dans le Grand Palais pour demander sa destitution. « Athanase faisait face à de graves accusations, explique Harold Drake, non seulement pour avoir illégalement pris possession de l’évêché de l’une des villes les plus grandes et les plus importantes de l’empire, mais aussi pour avoir maintenu sa position par la violence et la corruption. Dans son zèle à éliminer toutes les voix dissidentes, comme l’accusaient ses adversaires, il avait battu et emprisonné des membres du clergé rivaux et profané des biens de l’Église » [3]. Non sans avoir entendu la défense d’Athanase, Constantin le destitua et l’exila à Trèves, soit aussi loin que possible de sa base égyptienne. Il révoqua l’exil d’Arius et, peu avant de mourir, confia son âme à Eusèbe de Nicomédie, qui le baptisa. Dès lors, le credo homéousien tomba en discrédit à Constantinople, où tout le monde se satisfaisait du credo homéen (le Fils homoios au Père) vague et consensuel. Alexandrie restait divisée.
Constantin mourut en 337 et ses trois fils se partagèrent l’empire. Trois ans plus tard, il n’en restait plus que deux : Constance régnait à l’Est et Constant à l’Ouest, depuis Milan. Athanase profita de la mort de Constantin pour se faufiler à Alexandrie, mais il fut à nouveau banni par Constance, qui défendait l’orthodoxie homéenne de son père. Cependant, l’évêque deux fois déchu se réfugia à Rome et fit appel à son confrère, l’évêque Jules (qui n’était pas encore appelé « pape »). Ce dernier était indigné d’avoir été écarté des discussions agitant l’Empire oriental de langue grecque, et saisit l’occasion pour affirmer la primauté de Rome. « Ignorez-vous, écrivit Jules à l’évêque d’Antioche, que la coutume veut que l’on nous écrive d’abord, puis qu’une sentence juste soit prononcée depuis cet endroit ? » ( Épître de Jules à Antioche, §35). Constant, âgé de dix-huit ans, fut entraîné dans la controverse aux côtés du pape, dans le contexte de sa rivalité avec son frère. Ainsi, le différend qui avait pris naissance à Alexandrie s’était transformé en un début de schisme entre l’Occident latin et l’Orient grec.
Faible, inefficace et soupçonné d’homosexualité, Constant fut victime d’un coup d’État en 350. Constance vainquit l’« usurpateur » occidental Magnence trois ans plus tard et rétablit l’unité de l’Empire. Sous son initiative, la formule homéenne fut consacrée au concile de Sirmium (aujourd’hui en Serbie), imposée aux évêques italiens au concile de Rimini dans le nord de l’Italie (359) et réaffirmée au concile général de Constantinople (360) présidé par l’empereur. Après la mort de Constance et le bref règne de son cousin « apostat » Julien, l’Empire fut à nouveau divisé entre deux frères, Valentinien à l’Ouest et Valens à l’Est, chaque empereur se rangeant du côté de l’opinion de son évêque principal.
Peu après la mort de Valentinien (375) et de Valens (378), Théodose devint empereur d’Orient et lança immédiatement une campagne pour ramener les évêques orientaux au Credo de Nicée, légèrement retouché lors du concile de Constantinople (381). Il exila l’évêque homéen de Constantinople, nomma à sa place l’homéousien convaincu Grégoire de Nazianze, et réprima les émeutes populaires qui s’ensuivirent. À la mort de son co-empereur occidental Gratien (fils de Valentinien) en 383, Théodose se proclama seul empereur d’Orient et d’Occident, et le Credo de Nicée redevint pour la première fois depuis cinquante ans le fondement de l’orthodoxie impériale.
Le triomphe des homéousiens
Cela ne suffit toutefois pas à résoudre les dissensions. Dans les années 380, le non-chrétien Ammien Marcellin donnait raison à son mentor l’empereur Julien, qui affirmait qu’« aucune bête sauvage n’est aussi hostile à l’humanité que la plupart des chrétiens dans leur haine mortelle les uns envers les autres » (Histoire romaine XII.5). Quelques années plus tard, Augustin fit tristement remarquer que les chrétiens n’avaient qu’un seul dieu, mais qu’ils étaient plus divisés que les païens qui en avaient plusieurs. Ses écrits témoignent que la « Cité de Dieu » (l’Église) résonnait de discours sectaires haineux, de coups d’État ecclésiastiques, de lynchages et de meurtres [4]. Si l’on tient compte des travaux révisionnistes sur la persécution des chrétiens avant 312 [5], on peut affirmer sans se tromper que l’Empire est devenu beaucoup plus meurtrier pour les chrétiens à mesure qu’il se christianisait.
Le plus influent homme d’Église à la cour des empereurs Valentinien, Gratien et Théodose était Ambroise de Milan. Ambroise n’était pas un théologien, mais un politicien avisé, fils d’un préfet et lui-même gouverneur provincial local. Lorsque Milan, alors capitale impériale d’Occident, perdit son évêque homéen en 374, Ambroise intervint pour maintenir l’ordre, revendiqua l’évêché pour lui-même – ayant été acclamé par la foule, nous disent ses hagiographes – et obtint l’imprimatur de l’empereur Valentinien. Il n’était même pas baptisé à l’époque, note Charles Freeman, « mais en moins d’une semaine, il avait été baptisé et intronisé. Son ascension soudaine montre à quel point les besoins politiques, et surtout la nécessité de maintenir l’ordre, prédominaient désormais dans les nominations ecclésiastiques » [6]. Ambroise conserva une forte influence sur le fils de Valentinien, Gratien, qui succéda à son père à l’âge de huit ans, et son influence ne fit que croître sous Théodose.
Comme le parti homéen fut finalement vaincu, et que ce sont les vainqueurs qui écrivent l’histoire, la formule homoios devint le « blasphème de Sirmium ». Et dans une stratégie de condamnation par association, Ambroise dénigra les homéens en les qualifiant d’« ariens », bien que, selon Heather, « il n’y ait aucune preuve que le christianisme homéen ait eu un lien direct avec les enseignements d’Arius » [7]. Ainsi, explique Charles Freeman, « les homéens, qui mettaient l’accent sur la “similitude” entre le Père et le Fils, furent confondus avec ceux qui, plus proches de la tradition originale d’Arius, soulignaient la dissimilitude entre les deux » [8]. Ariani est devenu un mot-clé polémique utilisé par les catholiques pour désigner toutes sortes d’hérésies ; jusqu’au XIIIe siècle, même le catharisme a été déclaré Ariana haeresis [9]. Sous l’influence de leurs sources cléricales, les historiens de l’Église ont continué de désigner les homéens comme des « ariens » ou des « ariens modérés » jusqu’à ce que des chercheurs récents tels que Peter Heather et Charles Freeman mettent fin à cette habitude.
Il nous est difficile aujourd’hui de comprendre pourquoi les gens pouvaient même songer à se prononcer sur un mystère tel que la relation entre le Père et le Fils – sans oublier le Saint-Esprit, qui fera parler de lui lorsque Charlemagne cherchera querelle à Constantinople – et condamner à l’enfer ceux qui n’étaient pas d’accord. Mais nous devons comprendre que l’orthodoxie était une question d’autorité impériale, et donc un test de loyauté politique. Dotés depuis Constantin de privilèges judiciaires sans précédent, les évêques étaient des personnalités politiques de premier plan, qui remplaçaient la classe sénatoriale en tant que nouveaux arbitres de l’opinion politique. Harold Drake souligne leur importance dans Constantine and the Bishops :
« Les évêques. Pas le “christianisme”, une idéologie, ni “l’Église”, un monolithe abstrait, mais un ensemble de dirigeants disposant de bases de pouvoir locales qui, au cours de trois siècles, avaient développé des mécanismes pour travailler ensemble – ou les uns contre les autres – afin de promouvoir leurs intérêts mutuels et de présenter une autorité collective généralement capable de contrôler le potentiel particulièrement instable et anarchique de leur mouvement. » [10]
Ces évêques se disputaient les faveurs impériales ; avoir le dernier mot dans un concile et obtenir l’approbation de l’empereur leur conférait prestige et pouvoir. Ils savaient également comment gagner le peuple et exploitaient la tendance naturelle de l’opinion publique à la polarisation (personne n’adhère fermement à une opinion religieuse à moins qu’un clan rival ne défende l’opinion contraire).
Ces considérations peuvent aider à expliquer pourquoi le débat trinitaire s’est violemment polarisé entre les homéousiens et les homéens. Elles expliquent également pourquoi le christianisme nicéen, loin d’atteindre l’unité sous Théodose, sera déchiré par de nouveaux schismes. Le concile d’Éphèse (431) condamne les nestoriens qui pensent que la Vierge Marie est la mère du Christ mais pas la « mère de Dieu », et le concile de Chalcédoine (451) condamne les monophysites qui refusent le concept de deux natures en une seule personne. Les nestoriens trouveront refuge en Perse et on les verra influents à la Horde d’Or. Les monophysites resteront puissants en Égypte, en Syrie, en Arménie et en Asie Mineure, et n’opposeront aucune résistance à la domination islamique, la préférant à l’oppression byzantine.
Pendant ce temps, le christianisme homéen anti-nicéen n’avait pas dit son dernier mot. Au cours de la dernière décennie du Ve siècle, par un renversement étonnant de la division antérieure entre l’Orient et l’Occident, le christianisme homéen était devenu la religion officielle de toutes les parties occidentales de l’Empire, tandis qu’à l’Est, le christianisme nicéen-chalcédonien était l’orthodoxie impériale. Nous allons maintenant nous intéresser à cette partie largement oubliée de notre histoire religieuse sanglante.

Entrée en scène des Goths
Sous le règne de Constance, le prestigieux évêque Eusèbe de Nicomédie avait nommé un certain Ulfilas « évêque de Gothie ». Ulfilas était un chrétien romain dont les parents avaient été capturés par les Goths tervinges (Thervingi) qui occupaient la rive nord du bas-Danube. Affranchi, il avait converti un certain nombre de ses compagnons romains, ainsi que quelques familles goths. Après être revenu à Constantinople (dans des conditions inconnues), il retourna ensuite parmi les Goths sous protection impériale.
Les Goths tervinges formaient l’une des fédérations barbares relativement récentes qui s’étaient constituées à proximité de la frontière de l’Empire, au nord du Danube et à l’est du Rhin. Il y avait souvent eu des affrontements militaires entre eux et les légions romaines, espacés par des traités de paix en vertu desquels Rome leur versait une « aide étrangère » en or, en échange de leur engagement à protéger la frontière contre d’autres tribus, et d’autres services mercenaires occasionnels. Trois siècles d’échanges avec Rome avaient profondément transformé leur économie, leur démographie et leur structure politique. Quelles étaient leurs religions ? La réponse honnête, aussi décevante soit-elle pour les néo-païens, est que « nous n’en savons pas grand-chose et n’en saurons jamais rien » (Richard Fletcher [11]). Mais la plupart des sources suggèrent qu’ils partageaient le même paradigme réaliste que Constantin : les meilleurs dieux sont ceux qui apportent la victoire et la prospérité.
Ainsi, lorsque, en 376, plusieurs centaines de milliers de Goths tervinges, pressés par les Huns, supplièrent l’empereur Valens de les laisser s’installer au sud du Danube, ils obtinrent son autorisation à condition de se convertir au christianisme. Sozomen, historien ecclésiastique du Ve siècle, écrivit à propos de leur roi Fritigern : « Comme pour remercier Valens et lui garantir qu’il serait son ami en toutes choses, il adopta la religion de l’empereur et persuada tous les barbares sous son autorité d’adopter la même croyance » (Histoire ecclésiastique IV, 33) [12].
Naturellement, ces Goths se convertirent à l’orthodoxie impériale du moment, soit l’homéisme qui hiérarchise Dieu le Père et son Fils « unique », ce dernier existant depuis le commencement du monde, mais « étant soumis et obéissant en toutes choses à Dieu qui est son Père » (selon les termes d’une lettre d’Ulfilas).
L’année suivante, les Goths tervinges de Fritigern subirent un hiver très rigoureux, crièrent famine et réclamèrent des vivres au gouverneur romain local. Lorsque, en dépit d’un accord, leurs ravitaillement s’avéra insuffisant, ils prirent les armes et décimèrent l’armée romaine dans la bataille d’Andrinople (9 août 378), au cours de laquelle l’empereur Valens fut tué. Sous la conduite de leur roi victorieux Fritigern, les Goths envahirent les Balkans, pillant ville après ville. Au lieu de lever une armée capable de les repousser, le successeur de Valens, Théodose, conclut la paix avec Fritigern et le laissa s’installer en Mésie selon ses propres conditions. Richard Fletcher explique :
« L’entrée des Tervinges dans l’empire en 376, la victoire de Fritigern à Andrinople deux ans plus tard et l’installation de son peuple en Mésie quatre ans après, dans le cadre d’un accord, ne furent que les prémices d’un drame politique qui aboutit à l’effondrement de l’Empire romain d’Occident et à son remplacement par plusieurs États barbares. » [13]
Tous les historiens s’accordent aujourd’hui à dire que ni les Goths ni aucun des autres envahisseurs germaniques ne voulaient détruire l’Empire. Comme l’a déclaré l’historien belge Henri Pirenne il y a près d’un siècle,
« Rien n’animait les Germains contre l’Empire, ni motifs religieux, ni haine de race, ni moins encore de considérations politiques. Au lieu de le haïr, ils l’admiraient. Tout ce qu’ils voulaient, c’était s’y établir et en jouir. Et leurs rois aspiraient aux dignités romaines. » [14]
Bien qu’ils pillaient le territoire romain lors de leurs migrations, leur objectif était d’obtenir leur propre terre et de la cultiver sous la Pax Romana. Et leurs rois ne convoitaient rien de plus qu’un titre officiel romain de consul ou de général. Alaric, qui après la mort de Fritigern réunit les Goths tervinges et les Goths greutinges (désormais confondus sous le nom de Wisigoths), combattit courageusement avec ses hommes lors de la bataille du Frigidus (394) aux côtés des Romains, et estimait mériter le titre de magister militum. C’est par frustration face à l’ingratitude de l’empereur qu’il pilla Rome en 410 (voir chapitre précédent). En fait, aussi bizarre que cela puisse paraître, son gendre et successeur Athaulf considérait son peuple comme le protecteur de l’Empire, puisque les Romains eux-mêmes avaient perdu les vertus militaires qui avaient fait leur grandeur. Selon l’historien contemporain Paulus Orosius, Athaulf « choisit de rechercher pour lui-même au moins la gloire de restaurer et d’accroître la renommée des Romains par la puissance des Goths, souhaitant être considéré par la postérité comme le restaurateur de l’Empire romain » (Orosius, Historiae VII, 43) [15]. Il obtint la main de la sœur de l’empereur Honorius, Galla Placidia. Les Goths étaient très attachés à leurs coutumes et à leur langue, mais ils estimaient néanmoins mériter une forme d’égalité dans l’Empire romain. Ne leur avait-on pas dit dès le début que le christianisme serait leur passeport pour la romanité ?
Cependant, ils restèrent obstinément homéens, même après que Théodose eut déclaré leur foi hérétique et adopté des lois contre elle. Pourquoi ne se sont-ils pas convertis à la nouvelle orthodoxie à un moment donné ? On peut en deviner les raisons. Leur conversion au christianisme avait été un événement marquant dans leur histoire. Leurs croyances, leurs prêtres, leurs rituels faisaient désormais partie intégrante de leur identité ethnique. Ulfilas leur avait fourni un alphabet, une bible et une liturgie dans leur propre langue. De plus, ils restaient fièrement invaincus par Rome. Pourquoi se seraient-ils humiliés en se soumettant au nouveau dogme impérial ? Lorsque Récarède, le dernier roi wisigoth à régner sur l’Hispanie, la Gallécie et la Septimanie, s’est finalement converti en 589, son peuple s’est rebellé. Comme l’écrit Peter Heather à propos des Goths, des Burgondes et des Vandales :
« Le christianisme homéen offrait une idéologie distincte de l’orthodoxie romaine officielle, dont le chef spirituel était l’empereur lui-même. Dans le contexte de conflits au moins périodiques avec l’État romain central, il était tout à fait logique de s’emparer de cette forme alternative de christianisme pour construire ou maintenir l’identité collective au sein des coalitions nouvellement formées. » [16]
Du point de vue des empereurs, il était peut-être également pratique de maintenir une certaine distance religieuse avec ces barbares « hérétiques ». Il ne faut pas imaginer qu’à cette époque, les hérétiques étaient considérés comme bons à brûler sur le bûcher. Jusqu’à Justinien, les empereurs défendaient l’orthodoxie impériale, mais ne l’imposaient pas aux nations non romaines de leur œkoumène. Les hérétiques étaient victimes de discrimination et parfois chassés de la ville impériale, mais ils survivaient en tant que communautés. Compte tenu de leur puissance militaire et de leur statut de foederati, les Goths et les autres peuples germaniques se voyaient accorder une plus grande indépendance et étaient largement laissés à eux-mêmes. Ils croyaient à la fois au Christ et au caractère sacré de l’Empire, et cela était jugé suffisant.
Dans le prochain chapitre, nous nous intéresserons à l’histoire extraordinaire mais méconnue de Théodoric Ier, roi des Ostrogoths, le plus romain de tous les rois barbares, dont le contrôle s’étendit sur la majeure partie de l’Occident romain au nord de la Méditerranée, et qui était acclamé par ses sujets italo-romains et gallo-romains comme le restaurateur de l’Empire.












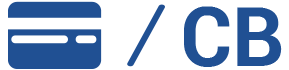
 et
et  !
!